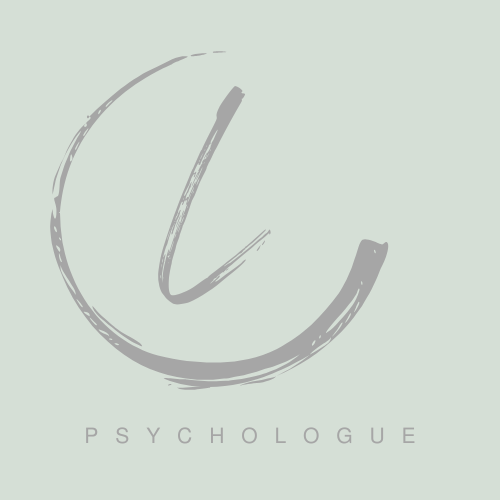Elle s’appelle Louane. 46 ans. Gendarme.
En 9 mois : elle a eu à gérer 6 accidents mortels, plusieurs interventions pour violences conjugales.
Aujourd’hui, elle dort mal, elle oublie des scènes de sa vie, elle s’éloigne de ses proches.
Louane souffre d’un traumatisme vicariant.
Le traumatisme vicariant, suis-je concerné ?
Nombre de professions (journalistes, magistrats, écoutants, greffiers, psychologues, travailleurs sociaux, professionnels de santé, gendarmes, policiers, professionnels de santé, etc…) sont exposées à un risque que l’on nomme aujourd’hui : le traumatisme vicariant.
Le traumatisme vicariant est un terme créé par Irene Lisa McCann et Laurie Anne Pearlman pour décrire l’impact psychologique du travail auprès de patients traumatisés sur les professionnels de divers métiers. Le traumatisme vicariant est aussi connu sous le nom de stress traumatique secondaire, terme inventé par Charles Figley.
Plus précisement, un traumatisme vicariant est un traumatisme apparu chez une personne « contaminée » par le vécu traumatique d’une autre personne avec laquelle elle est en contact. Le traumatisme vicariant résulte de l’investissement empathique avec les récits des personnes ayant été directement confrontées aux évènements, et non à l’exposition direct de l’évènement.
Autrement dit, il s’agit d’un traumatisme par extension.
Par ailleurs, on peut aujourd’hui penser que le système des neurones miroirs joue probablement un rôle dans cette transmission, notamment par contamination physiologique et sensorielle.
Les professionnels qui ont entendu des victimes, peuvent avoir des images envahissantes des scènes racontées. A contrario de souvenirs, il s’agit de créations de l’esprit, des créations qui s’imposent à eux. Les professionnelles risquent d’éprouver des symptômes similaires à ceux des victimes directes. Les symptômes varient selon les individus ; ils peuvent prendre la forme de cauchemars, d’images obsédantes, intrusives, d’hypervigilance, d’insomnies, de conduites d’évitement et bien d’autres. Si nous ne sommes pas vigilant, ces signes peuvent provoquer une sorte de fatigue compassionnelle, voire un burn-out.
Comment préserver la santé mentale des professionnels ? Votre santé mentale ?
Tout d’abord, il s’agit de prendre conscience qu’un traumtisme vicariant s’exprime en vous, puis repérer surtout les symptômes particuliers qu’il provoque en soi. Ensuite, il faut également apprendre à s’apaiser soi-même, voire à se protéger, en développant des stratégies de soin. (Votre employeur est responsable de porter vigilance aux risques liés à votre travail, en en intercalant des tâches exposées à ce risque et d’autres plus tranquilles, moins exposées. Puis, en proposant un soutien ou une supervision par un(e) psychologue spécialement formé(e)).
Quelle est la conduite à tenir face au traumatisme vicariant ?
La bonne nouvelle c’est que le traumatisme vicariant : ça se soigne, ça se prévient et ça s’accompagne.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès d’un psychologue pour :
– apprendre à reprérer les signes de détresse.
-maintenir une posture professionnelle juste qui vous préserve.
– apprendre à gérer autrement vos émotions.
– construire et entretenir les stratégies d’auto-soins.
(Attention : le traumatisme vicariant n’est pas à confrondre avec la fatigue de compassion).
Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site, dans la rubrique « Contact », afin de bénéficier d’un accompagnement psychologique.
Prenez soin de vous.
A bientôt.
Article écrit par Lucille COURTOT, pscyhologue clinicienne.